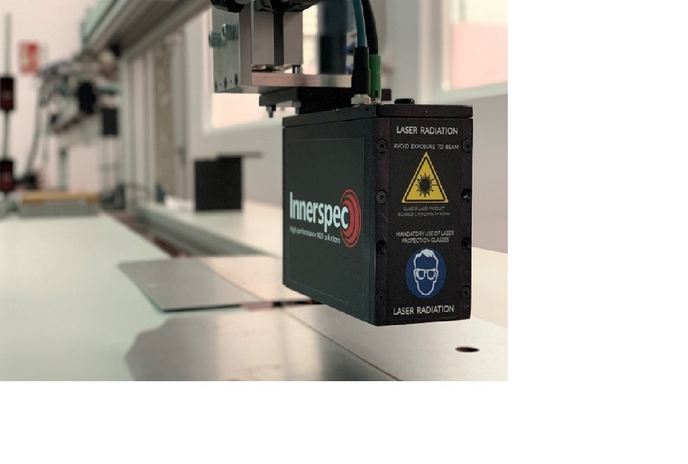Amis ou ennemis: une nouvelle plateforme pour prédire la toxicité des nanoparticules
Les nanomatériaux sont vantés pour leurs caractéristiques physicochimiques uniques, généralement attribuées à leur petite taille, leur grande surface, leur composition chimique, leur solubilité, leur forme et leur agrégation. Leurs implications s’étendent à des secteurs allant de l’agriculture et de l’ingénierie à la science des matériaux et à la médecine. Cependant, leur utilisation peut également avoir de graves conséquences sur l’environnement et la santé, en dépit de leurs propriétés avantageuses par rapport à celles des matériaux en vrac.
Les piliers de la production durable de nanomatériaux
«Prévoir la sécurité des nanomatériaux implique de comprendre la nature ultime de ce qui rend un matériau toxique. Cela nécessite une compréhension approfondie de toutes les étapes du cycle de vie des nanoparticules manufacturées: la source, le devenir, l’exposition, la dose et la réponse. Tous ces éléments sont étroitement liés», note Miguel A. Bañares, professeur à l’Institut de catalyse et de pétrochimie du CSIC à Madrid et coordinateur du projet NanoInformaTIX(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE. NanoInformaTIX a dévoilé un outil nanoinformatique qui combine tous ces éléments pour découvrir ce qui rend un nanomatériau toxique. «Nous devons d’abord connaître le devenir environnemental des nanoparticules manufacturées, à savoir comment elles se comporteront lorsqu’elles interagiront avec l’environnement: se sédimenteront-elles ou resteront-elles libres? Leur devenir dans l’environnement permet à son tour de déterminer la probabilité d’une exposition humaine et les risques sanitaires associés en fonction de la quantité (dose) qui interagit avec les cellules et les tissus. En fin de compte, notre physiologie et les voies d’entrée des nanoparticules dans notre corps déterminent largement la distribution des nanomatériaux», ajoute Miguel Bañares.
Surmonter la fragmentation des données en nanotoxicologie
Les résultats d’une nouvelle étude viennent s’ajouter à la grande quantité de données sur les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des nanoparticules manufacturées produites au cours des dernières décennies. Pourtant, ces données sont largement dispersées. Le cadre nanoinformatique durable basé sur le web NanoInformaTIX(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) intègre les données existantes et émergentes dans des interfaces efficaces et conviviales afin d’améliorer l’accessibilité et l’utilisation des modèles nanoinformatiques pour l’industrie, les régulateurs et la société. «Nous avons utilisé des outils informatiques de pointe issus de différents domaines scientifiques pour extraire des informations qui peuvent être associées à la nanotoxicologie», explique Miguel Bañares. Par exemple, la plateforme intègre eNanoMapper(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), l’une des plus grandes sources de données sur les propriétés toxicologiques des nanomatériaux.
Construire une image globale de la toxicité des nanoparticules
«Notre compréhension de la manière dont les nanoparticules interagissent entre elles, avec l’environnement et avec les cellules/tissus de notre corps serait limitée si nous n’ajoutions à notre plateforme que des données et des modèles (éco)toxicologiques de pointe. Nous devons également connaître les raisons de leur comportement», souligne Miguel Bañares. À cette fin, une partie des travaux s’est concentrée sur la création de nouveaux modèles décrivant les nanoparticules elles-mêmes, à savoir comment leur structure, leur forme et leurs défauts peuvent déterminer leurs interactions avec l’environnement et nos cellules. Il est important de noter que ces modèles ont été validés à l’aide d’expériences spécialement conçues pour aider à générer des descripteurs de toxicité pertinents. Les nouveaux modèles et descripteurs de toxicité sont essentiels pour développer des modèles d’exposition, de biodistribution et de dose-réponse. La plateforme NanoInformaTIX intègre également des modèles de sécurité dès la conception, ce qui permet de réduire les risques de toxicité dès les premières étapes de la production de nanomatériaux. En fin de compte, l’outil utilise des données expérimentales pour étudier la réactivité des surfaces et des approches omiques pour déterminer les effets biologiques néfastes des interactions entre les nanoparticules et les cellules. «D’une part, nous avons extrait des données qu’il serait très difficile d’obtenir ou dont la génération par le biais d’expériences serait onéreuse. D’autre part, l’utilisation combinée d’outils et de nouveaux modèles nous aide à mieux comprendre les mécanismes les plus fondamentaux à l’origine de la toxicité des nanomatériaux manufacturés avancés», fait remarquer Miguel Bañares.