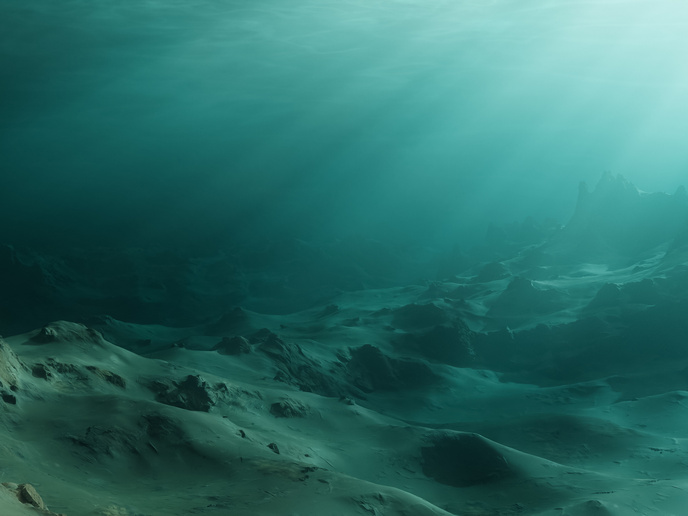Les minéraux pourraient être la clé du carbone bleu
Le carbone bleu, c’est-à-dire le carbone stocké dans les écosystèmes côtiers et marins, y compris les sédiments des fonds marins, a été reconnu comme jouant un rôle important dans la limitation de l’impact du changement climatique. Cependant, on ne comprend pas bien comment le carbone organique, issu d’organismes ayant vécu, évite d’être décomposé par les microbes pour être conservé dans les sédiments pendant des millions d’années. «Le fait que du carbone organique ait été préservé est profondément déroutant», note Caroline Peacock, coordinatrice du projet MINORG et professeure de biogéochimie au sein du département Terre et environnement de l’université de Leeds, au Royaume-Uni. «Notre projet visait donc à découvrir les causes de l’enfouissement du carbone dans les sédiments et l’importance des minéraux dans ce processus.» «C’est important car l’enfouissement du carbone dans les sédiments contribue à réguler le climat à long terme sur Terre», ajoute-t-elle. «Sur de longues périodes, l’enfouissement du carbone organique dans les sédiments accumule également de l’oxygène dans l’atmosphère.» Et même sur des échelles de temps plus courtes, «chaque parcelle de carbone enfouie dans les sédiments est, dans une certaine mesure, soustraite à l’atmosphère».
Des expériences pour déterminer l’association minérale
Des minéraux similaires à ceux que l’on trouve dans les sédiments marins ont été synthétisés en laboratoire, afin d’étudier les mécanismes par lesquels les différents types de carbone présents dans l’environnement marin s’y associent. «Nous avons cherché à savoir exactement comment une molécule spécifique de carbone se fixe à une surface minérale», explique Caroline Peacock. Il a ainsi été démontré que les minéraux présents dans les sédiments marins, en particulier ceux composés de fer et de manganèse, emprisonnent le carbone organique et le protègent de la dégradation. Les changements de température, de salinité, de pH et d’autres paramètres ont par ailleurs été étudiés en laboratoire et quantifiés. Caroline Peacock explique que: «Nous voulions comprendre la stabilité de ces mécanismes d’attachement, par exemple s’ils survivent à l’enfouissement dans les sédiments ou aux différents changements chimiques ou biologiques qui se produisent au cours de l’enfouissement.» «Notre principale conclusion est que le type de carbone le plus important pour la préservation et l’enfouissement est le carbone riche en carboxyle», note la chercheuse. Il provient de la décomposition du phytoplancton marin. «Le carbone carboxyle est fortement associé aux minéraux parce que les forces d’attraction entre le carbone et les minéraux sont très élevées et demeurent tout au long des changements biologiques, probablement à long terme au cours de l’histoire de la Terre.»
Modèle biogéochimique simulant le plancher océanique
Le projet, financé par le Conseil européen de la recherche, a permis d’élaborer un modèle prédictif à partir de zéro. «Nous avons réuni tous ces processus enregistrés dans un modèle biogéochimique, une sorte de simulation des fonds marins, que nous avons pu utiliser pour prédire le cycle du carbone entre les sédiments et l’eau de mer», souligne Caroline Peacock. «Notre modèle montre qu’environ 60 % du carbone enfoui est associé à des minéraux tels que le fer et le manganèse, qui, dans l’océan moderne, peuvent changer d’un endroit à l’autre et encore plus sur de longues périodes.» «Si la disponibilité du fer contrôle l’enfouissement du carbone, alors l’enfouissement du carbone variera, car nous savons que la disponibilité du fer a considérablement varié au cours de l’histoire de la Terre», explique-t-elle, soulignant que «cela a des implications importantes pour le climat, l’oxygénation et même l’évolution biologique».
Géopolymérisation
Le projet a également révélé que, dans certaines circonstances, le carbone présent dans les sédiments se transforme en un type de carbone très peu réactif. «Nous appelons cela la géopolymérisation, des formes relativement simples de carbone se polymérisent, c’est-à-dire qu’elles se lient, pour former des molécules beaucoup plus grandes et très stables», explique Caroline Peacock. «Nous avons effectué une modélisation qui a montré que sans cet enfouissement de carbone géopolymérisé, les températures à la surface de la Terre auraient probablement été très différentes, et l’oxygénation de la planète aurait aussi été différente pendant des millions et des millions d’années. C’est une découverte importante», ajoute-t-elle. Bien que le projet se soit concentré sur la manière dont ces processus ont façonné la planète au cours de l’histoire, Caroline Peacock note qu’il est intéressant d’apprendre à les manipuler si l’on veut améliorer les stocks de carbone bleu à l’avenir.
Mots‑clés
MINORG, carbone bleu, sédiments des fonds marins, sédiments, climat, fer, manganèse, carbone carboxylique, modèle biogéochimique, plancher océanique, cycle du carbone, évolution, géopolymérisation