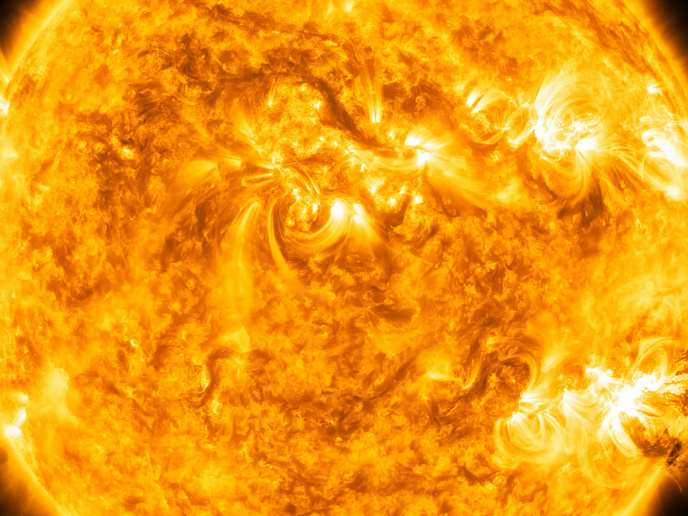De nouvelles techniques d’imagerie lèvent le voile sur les creusets planétaires avec une précision inédite
L’un des principaux objectifs de l’astrophysique est de détecter les planètes en cours de formation dans leur environnement natal que sont les disques protoplanétaires constitués de gaz et de poussière, âgés tout au plus de quelques millions d’années. Le projet ImagePlanetFormDiscs, financé par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), a élaboré des techniques d’imagerie qui contribuent aux recherches à des échelles d’un niveau de détail jamais atteint, équivalent à une infime portion de l’orbite de la Terre dans le système solaire. Le projet a également eu recours à des simulations pour illustrer la réaction de ces disques à la présence d’une planète ou à l’attraction gravitationnelle de plusieurs étoiles. L’étude de l’accrétion de la matière dans un jeune système d’étoiles binaires a permis à l’équipe de montrer que les techniques d’interférométrie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) permettent de séparer les contributions de l’accrétion d’une étoile compagnon de celles de l’étoile primaire de plus grande taille. «Nos études ont sondé différentes longueurs d’onde et échelles spatiales afin de reconstituer les disques protoplanétaires dans leur intégralité, depuis des échelles équivalant à l’orbite de Mercure jusqu’à dix fois l’orbite de Neptune dans notre système solaire», explique Stefan Kraus(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), coordinateur du projet.
Scruter la poussière
L’équipe a caractérisé le disque de GW Orionis(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), qui présente une forme étrange, et a créé un modèle tridimensionnel en combinant des images thermiques de la poussière et des images de la lumière diffuse. «Lorsque nos observations ont montré que le disque est fortement déformé et non plat, nous avions crié “eurêka”. Afin de comprendre l’origine de cette distorsion extrême du disque, nous avons cartographié les orbites précises des trois étoiles en son centre», ajoute Stefan Kraus. Une simulation du disque autour de GW Orionis donne à penser que l’attraction gravitationnelle de chacune de ces trois étoiles a déchiré et déformé le disque. «Bien que le processus de déchirure du disque ait été prédit de manière théorique, c’est la première fois qu’il a été réellement observé», fait remarquer Stefan Kraus. L’équipe a également capturé des images du disque autour de l’étoile V1247 Orionis(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), bien étudiée par l’ALMA et le VLT, à différentes longueurs d’onde, ce qui a débouché sur la découverte d’une asymétrie en forme de croissant révélatrice d’un vortex capable de piéger la poussière, éventuellement généré par une planète pas encore découverte(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). En outre, en recourant à l’interférométrie à haute résolution spectrale, l’équipe a mesuré pour la première fois l’orientation spin-orbite d’un système exoplanétaire repéré directement, à savoir Beta Pictoris.
Interférométrie
Les étoiles et les planètes se forment par accrétion, phénomène par lequel la matière d’une grande structure s’ajoute à une structure plus petite. ImagePlanetFormDiscs a appliqué des techniques d’interférométrie pour étudier la structure des disques à l’origine de la formation des planètes, localiser l’accrétion et vérifier si l’imagerie interférométrique permet de détecter des jeunes planètes. L’interférométrie utilise plusieurs télescopes pour obtenir des images d’une précision inédite. Le Michigan InfraRed Combiner (MIRC) du réseau de télescopes CHARA(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) avait déjà capturé des structures à la surface des étoiles, mais ne possédait pas la sensibilité nécessaire pour observer les jeunes étoiles pâles. ImagePlanetFormDiscs a accru la sensibilité de l’instrument en remplaçant la caméra et d’autres composants du système optique. L’équipe a été épaulée dans ses efforts par une nouvelle génération de détecteurs infrarouges qui amplifient les signaux. Capable de figer efficacement des images de turbulences atmosphériques à une vitesse de plusieurs milliers d’images par seconde, ce détecteur «à photodiode d’avalanche d’électrons» a accru la sensibilité de l’instrument MIRC d’environ un facteur de 20. «Le MIRC-X(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) est l’imageur infrarouge qui affiche la plus haute résolution au monde et a permis de réaliser les premières observations interférométriques de jeunes étoiles avec une précision de plus d’un millionième de degré», explique Stefan Kraus. Ces observations ont été complétées par des données issues des instruments PIONIER, GRAVITY et SPHERE au Très Grand Télescope de l’ESO(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) au Chili, ainsi que du réseau d’antennes submillimétrique ALMA. Dans le cadre d’un nouveau projet baptisé GAIA-BIFROST, l’équipe va à présent construire un instrument pour l’Interféromètre du Très Grand Télescope, qui fonctionnera dans la même plage de longueur d’onde que le MIRC-X.