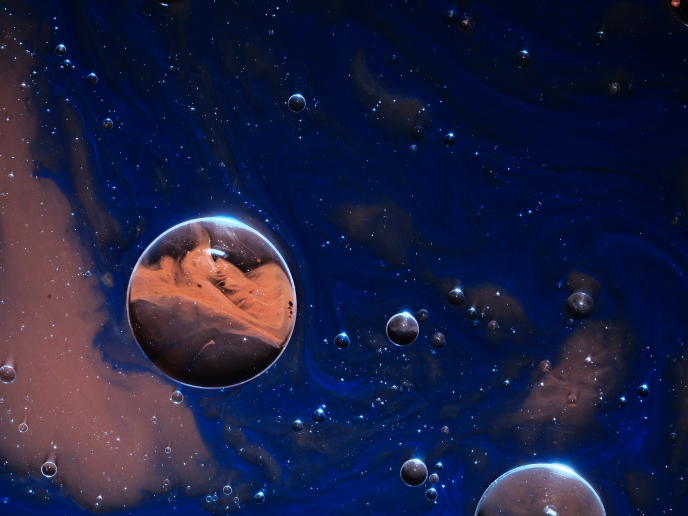L’évolution des comètes, clé de la compréhension du cosmos
Les comètes sont considérées comme les survivants les plus intacts de la formation de notre système solaire, ce qui pourrait nous fournir des indices sur les conditions qui régnaient à l’époque. Pour interpréter ces indices, il faut d’abord comprendre le fonctionnement des comètes et la mesure dans laquelle elles ont échappé à la transformation au cours de l’histoire du système solaire. «C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet THEMISS(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) », explique la coordinatrice du projet, Aurélie Guilbert-Lepoutre, du Centre national de la recherche scientifique(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (CNRS), en France. «Nous voulions comprendre le degré de transformation thermique des comètes en général, et au cours de l’âge du système solaire en particulier.»
Explorer le traitement thermique des comètes
Le projet THEMISS, soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), visait à explorer le traitement thermique des comètes depuis leur stockage dans les réservoirs extérieurs du système solaire (le nuage d’Oort et la ceinture de Kuiper), puis à modéliser leur évolution jusqu’à aujourd’hui. «Nous voulions d’abord comprendre quelles propriétés sont essentielles pour déterminer l’évolution des comètes», ajoute Aurélie Guilbert-Lepoutre. «Nous avons ensuite voulu évaluer l’influence du traitement thermique sur l’âge du système solaire. Sur une échelle de temps aussi longue, la prise en compte de l’évolution orbitale des comètes était essentielle: à notre connaissance, cet aspect n’avait jamais été pris en compte auparavant.» L’équipe du projet a également entrepris de comprendre la survie des matériaux hautement volatils, grâce à des expériences de laboratoire novatrices conçues pour recréer les conditions cométaires.
Séquence évolutive de l’activité cométaire
Ce travail, basé sur des observations et des modélisations numériques, a abouti à plusieurs résultats intéressants. L’analyse des grandes dépressions des comètes de la famille de Jupiter (JFC) a notamment permis à l’équipe d’étudier l’interaction complexe entre les structures de surface et l’activité cométaire. «L’activité cométaire a tendance à effacer les caractéristiques morphologiques marquées - elles deviennent plus larges et moins profondes avec le temps», explique la chercheuse. «À partir de là, nous avons pu établir une séquence évolutive qui va des surfaces cométaires “jeunes”, avec une topographie de surface nette propice aux explosions, aux surfaces cométaires “vieilles”. Notre travail fournit donc le contexte physique nécessaire à la compréhension de l’évolution des surfaces cométaires.» Les résultats du projet suggèrent également que tous les JFC subissent de multiples épisodes de réchauffement qui entraînent des modifications significatives de leur teneur initiale en matières volatiles. «Cela suggère que les couches qui contribuent à l’activité cométaire observée aujourd’hui ne sont pas représentatives de leurs origines», note encore Aurélie Guilbert-Lepoutre.
Les observations cométaires en contexte
Le projet a souligné qu’il est essentiel de comprendre le traitement thermique subi au cours de l’âge du système solaire pour replacer toute observation de comète dans son contexte plus large. «Nous suggérons que toutes les comètes ont été modifiées depuis leur formation», explique Aurélie Guilbert-Lepoutre. «Il est important de tenir compte de ces modifications si nous voulons utiliser leurs propriétés comme indices de la formation du système solaire. Nous montrons également que certaines comètes ont subi un traitement relativement limité, ce qui est très positif et porteur d’espoir!» Un certain nombre de prédictions avancées vont maintenant être testées dans le cadre d’observations et de missions futures. «Le fait de disposer de cette base théorique issue du projet THEMISS aidera certainement à interpréter la grande quantité de données qui arriveront dans les années à venir», ajoute Aurélie Guilbert-Lepoutre. Les expériences en laboratoire sur les matériaux volatils sont toujours en cours et Aurélie Guilbert-Lepoutre espère pouvoir caractériser pleinement les dépôts d’eau et de gaz dans les conditions propres aux noyaux cométaires. «Il s’agit d’une nouvelle ligne de recherche interdisciplinaire qui s’étendra au-delà de la durée du projet», remarque-t-elle. «Nous travaillons à la publication des résultats, dans le but d’obtenir un financement supplémentaire pour l’avenir.»