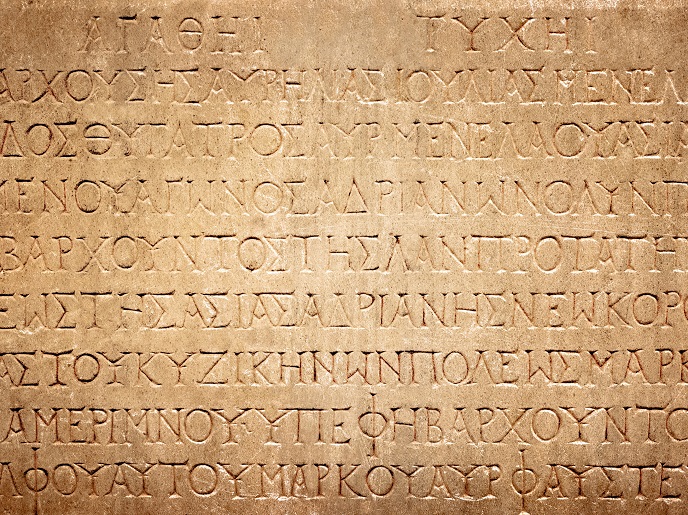Aperçu de la biodiversité historique du Brésil
«Historia Naturalis Brasiliae»(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (HNB) est une encyclopédie de l’histoire naturelle du Brésil publiée aux Pays-Bas en 1648, à la suite de la colonisation néerlandaise du nord-est du pays, de 1630 à 1654. Le livre a été compilé par le naturaliste néerlandais Johannes de Laet qui s’est inspiré des recherches du naturaliste allemand George Marcgraf et du médecin néerlandais Willem Piso. Il compte plus de 800 entrées sur les plantes et les animaux brésiliens, dont beaucoup sont accompagnées d’illustrations gravées sur bois, qui présentent pour la première fois certaines plantes aux Européens. «Le HNB étant influencé par les expériences partagées des populations indigènes et des Africains réduits en esclavage, il offre un aperçu des mécanismes d’élaboration des connaissances dans le Brésil néerlandais colonial et, a fortiori, du contexte interculturel dans lequel la science moderne a vu le jour», explique Mariana Françozo de l’université de Leyde(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et coordinatrice du projet BRASILIAE(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). En étudiant la manière dont le livre a été produit et dont ses connaissances botaniques concernent des pratiques brésiliennes actuelles, le projet a apporté un éclairage sur la biodiversité et la société passées et actuelles. Pour examiner plus attentivement l’accueil réservé au HNB au début de l’époque moderne, l’équipe s’appuie à présent sur le recensement des exemplaires de bibliothèques ayant survécu, publié dans le cadre d’un ouvrage en libre accès(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Examen d’un instantané de l’histoire
Le HNB rassemble des informations sur les différents peuples du littoral brésilien pendant la période coloniale, tout en documentant les espèces végétales (y compris les noms et les utilisations) apportées par les Africains réduits en esclavage. Le projet a adopté une méthodologie pluridisciplinaire comprenant: des analyses documentaires, l’identification et la taxonomie des plantes, des analyses visuelles, quelques datations par radiocarbone(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et des analyses isotopiques, ainsi que des recherches ethnographiques et historiques basées sur des sources primaires. «Nous avons consulté des documents des Archives nationales néerlandaises, et utilisé le logiciel Transcribus pour nous aider avec la paléographie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) des documents», ajoute Mariana Françozo.
Différents avantages au niveau de l’exploitation
L’équipe a découvert qu’une partie de la flore illustrée est typique non seulement du nord-est du Brésil, mais aussi d’autres régions(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), (en particulier de l’Amazonie), révélant des informations sur les migrations antérieures à la conquête européenne. L’inclusion par HNB d’un dessin de tournesol, annoté de son nom indigène (Tupi), suggère qu’il avait peut-être déjà été introduit au Brésil au XVIIe siècle(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), et non au XXe comme nous le pensions. L’équipe a également identifié et reconstitué la structure des systèmes de traite et d’esclavage des Africains et de leurs descendants dans le Brésil néerlandais. Un chercheur continue d’examiner la manière dont la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales a organisé la traite des esclaves: leur vente et la gestion du travail, ainsi que la manière dont ils ont fait face à leur oppression. Le projet a également permis de constater que le HNB contient des informations sur des plantes et des animaux qui restent reconnaissables pour les peuples indigènes de langues tupi d’aujourd’hui. «Il s’agit d’une preuve de la résilience et de la pérennité des traditions indigènes, qui souligne la valeur du travail réalisé sur les documents historiques aux côtés des peuples indigènes», note Mariana Françozo.
Ouvrir l’accès aux ressources patrimoniales
Le projet a organisé un atelier avec le peuple Ka’apor(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) au Naturalis Biodiversity Center(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) à Leyde, (partenaire du projet). Les Ka’apor ont ainsi eu accès à la collection interne, ce qui leur a permis de trouver des documents issus de leur culture et de discuter de la préservation de la forêt tropicale amazonienne. «Je me souviens qu’en évoquant son pays d’origine, l’ancien a dit: “Nous avons aussi des oiseaux dans notre musée, mais là, ils peuvent encore voler”», poursuit Mariana Françozo. L’équipe collabore actuellement avec les Ka’apor afin d’élaborer un atlas détaillant l’emplacement des objets Ka’apor dans les collections des musées européens, et de mettre en place un projet de cocréation portant sur la redécouverte de techniques de poterie qui ne sont plus pratiquées. Les résultats seront également intégrés au projet REFLORA(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) du gouvernement brésilien, qui contribue à préserver les connaissances relatives à la biodiversité florale du passé.