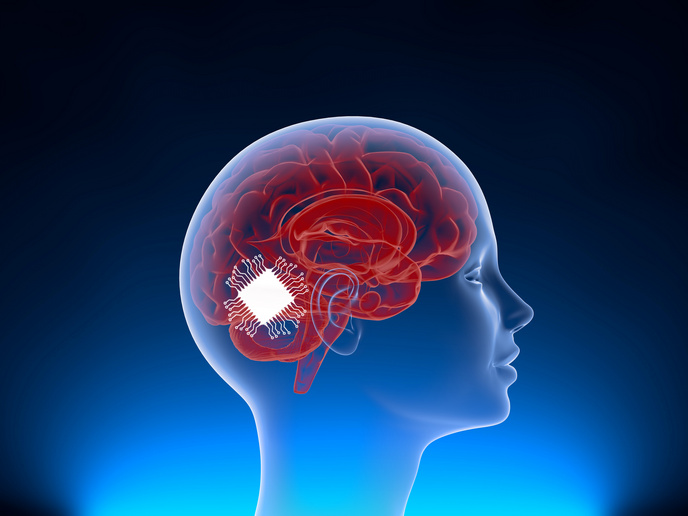De nouveaux dispositifs bioniques relient la biologie et l’électronique
Les dispositifs bioniques intégrés, tels que les implants auriculaires cochléaires et les yeux bioniques, sont conçus pour remplacer ou compléter les fonctions naturelles du corps. Un problème majeur persiste toutefois: les interfaces bioniques actuelles sont encore très «mécaniques» par rapport aux tissus humains. «Les métaux traditionnels et les polymères rigides qui les composent peuvent provoquer une inflammation et laisser des cicatrices, ce qui, au fil du temps, dégrade les performances», explique la coordinatrice du projet Living Bionics Rylie Green(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’Imperial College(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) au Royaume-Uni. «Même de minuscules mouvements peuvent provoquer des micro-lésions.» De nombreux dispositifs bioniques sont également chimiquement inertes, ils ne communiquent donc pas activement et ne s’adaptent pas à l’environnement biologique. Ce défaut d’intégration est la raison sous -jacente à la diminution de leurs performances, généralement après des mois ou des années dans le corps.
Connecter la biologie et l’électronique
L’objectif du projet Living Bionics, soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), était de repenser la manière dont nous connectons la biologie et l’électronique, et de créer des interfaces qui ne sont pas seulement tolérées par le corps, mais qui en font partie. «Nous voulions concevoir des “électrodes vivantes” qui combinent des matériaux souples et conducteurs avec des composants biologiques capables de s’intégrer directement aux cellules et aux tissus», confie Rylie Green. «Notre principal objectif était d’abandonner l’usage d’implants rigides au profit de systèmes adaptatifs et régénératifs qui évoluent avec le corps.» Pour ce faire, le projet a concentré ses efforts sur le développement de matériaux biohybrides. Il s’agissait notamment d’hydrogels, d’élastomères et de matériaux modifiés qui contiennent des composants natifs du corps, et en particulier du cerveau. Ces matériaux sont doux et flexibles comme du tissu, mais peuvent néanmoins parfaitement transmettre des signaux électriques. «La combinaison de cellules souches et des signaux nécessaires à la production de tissu neuronal sain dans le dispositif était également un élément essentiel», ajoute Rylie Green.
Concevoir de véritables «électrodes vivantes»
L’équipe du projet a construit des modèles de tissus neuronaux 3D afin d’étudier la manière dont les cellules interagissent avec différentes compositions chimiques de matériaux et a mené des évaluations des performances électriques et mécaniques. Ces tests ont contribué à démontrer que certains nouveaux matériaux peuvent maintenir la conductivité et la viabilité cellulaire sur de longues périodes. L’équipe a également pu démontrer que des combinaisons de matériaux et de cellules peuvent être ajoutées à l’interface d’un dispositif bionique et créer des connexions cellulaires naturelles avec les tissus cérébraux(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) adjacents. Comprendre comment les propriétés physico-chimiques de certains polymères et hydrogels affectent l’attachement cellulaire et la fonction à long terme a constitué une autre avancée majeure. «Conceptuellement, nous avons établi une voie vers de véritables “électrodes vivantes”, où les cellules modifiées peuvent interagir avec les neurones hôtes de manière contrôlée et stable», explique Rylie Green. «Nous avons démontré que cela fonctionne non seulement dans une boîte de Pétri, mais aussi dans le cerveau d’un rongeur vivant.»
De nouvelles thérapies bioélectroniques régénératives
Les prochaines étapes incluront une validation plus rigoureuse de ces systèmes dans des modèles animaux afin de confirmer la biocompatibilité à long terme et la stabilité du signal. Les méthodes de fabrication doivent encore être affinées afin que les matériaux puissent être mis à l’échelle et stérilisés en vue d’une utilisation clinique. «La collaboration avec les partenaires de l’industrie sera essentielle pour répondre aux exigences réglementaires et envisager des études de faisabilité précoces sur l’humain», ajoute Rylie Green. À long terme, Rylie Green et son équipe espèrent que ce travail redéfinira ce que peut être un «implant médical». «Au lieu d’un matériel inerte qui se dégrade avec le temps, nous imaginons des systèmes vivants et adaptatifs qui guérissent avec le corps et restaurent les fonctions de manière plus naturelle», explique-t-elle. «Cela ouvrirait la voie à une nouvelle génération de thérapies bioélectroniques régénératrices, où la frontière entre le dispositif et le tissu deviendrait presque transparente.»