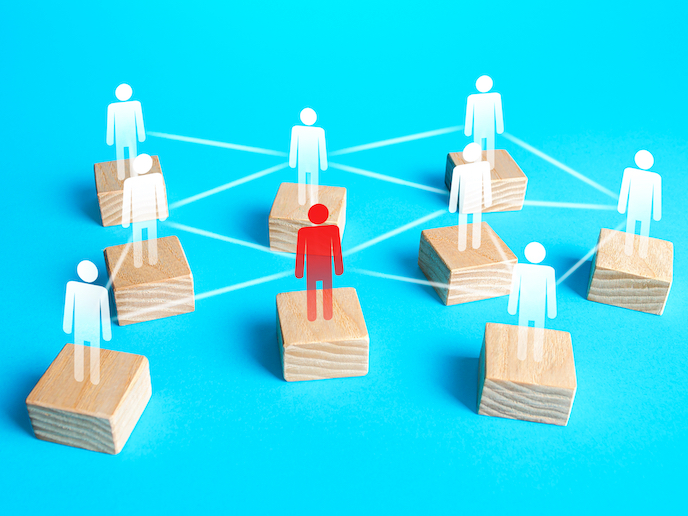Responsabilité individuelle des préjudices systémiques
Les préjudices systémiques sont causés ou perpétués par une série d’agents différents, aucun n’ayant, à eux seuls, une maîtrise directe du résultat. Les exemples courants comprennent le changement climatique, le travail dans des ateliers clandestins et la sous-représentation de certains groupes aux postes de pouvoir dans la société. «Bien qu’aucun individu ne puisse être tenu responsable de ces préjudices, prise collectivement, la somme de nos actes a une très grande importance», explique Säde Hormio(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), chercheuse à l’Université d’Helsinki(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). «En fait, elle peut notamment faire la différence entre des émissions stabilisées et le chaos climatique.» Dans cette optique, il faut donc se poser la question suivante: les individus peuvent-ils être tenus responsables de préjudices systémiques? Avec le soutien du projet CIRICC, financé par l’UE, Säde Hormio a entrepris d’apporter une réponse à cette question. Plus particulièrement, le projet, soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), cherchait à expliquer la manière dont les individus peuvent être tenus responsables de préjudices systémiques causés collectivement et à déterminer à quel moment un collectif doit être tenu responsable. «La compréhension de l’impact que chacune de nos actions peut avoir sur le collectif est la première étape pour remédier aux préjudices systémiques d’aujourd’hui», ajoute Säde Hormio.
Définition de la responsabilité collective
Säde Hormio s’est d’abord attelée à la tâche de définir la responsabilité collective. «En dehors du monde juridique, la notion de “collectivité organisée”, comme une entreprise, est loin d’être claire», explique Säde Hormio. Elle estime qu’il est difficile d’envisager les collectifs organisés (gouvernements, universités et entreprises) comme des agents moraux. Cela est dû au fait que les agents collectifs sont dépourvus des émotions morales nécessaires pour ressentir l’appel du raisonnement moral. De plus, leurs processus de prise de décisions mécanistes ne peuvent pas réagir d’eux-mêmes de manière réfléchie aux questions morales. Ceci dit, Säde Hormio fait remarquer que les collectifs organisés peuvent parvenir à un raisonnement moral par le biais de leurs membres. «Les actes et omissions individuels ne peuvent, à bien des égards, être dissociés des processus collectifs dont ils font partie», précise-t-elle. «Qui plus est, les positions morales adoptées par les agents moraux dans le cadre de leurs rôles, et façonnées par l’ethos collectif, fait naître la vision morale collective de l’agent concernant une question donnée.» Sur la base de cette philosophie, Säde Hormio conclut que les agents collectifs sont, de facto, des acteurs moraux, capables de conserver leurs propres visions morales et d’exprimer des positions collectives. «À ce titre, les agents collectifs, en qualité d’acteurs moraux, peuvent être tenus pleinement responsables de leurs actes et omissions», ajoute-t-elle.
Motiver les gens à passer à l’action
En d’autres termes, les individus ne doivent pas être considérés au premier chef comme des électeurs ou des consommateurs isolés. «Les contributions individuelles aux préjudices systémiques peuvent être si modestes qu’elles ne font aucune différence pertinente pour les résultats collectifs, bons ou mauvais soient-ils», fait remarquer Säde Hormio. «Cela dit, les individus doivent se soucier d’inciter à des changements systémiques». Säde Hormio donne l’exemple du changement climatique. «Nous n’émettons pas de gaz à effet de serre en vase clos», explique-t-elle. «Mais nous sommes membres de différents collectifs, qui produisent de grandes quantités de gaz à effet de serre et qui, à terme, sont responsables du changement climatique.» Säde Hormio estime que le chevauchement de nos appartenances à différents collectifs organisés devrait être au cœur du débat sur les actions que les individus devraient entreprendre pour lutter contre les préjudices sociaux. «Nous devrions évaluer notre rôle au sein des collectifs organisés, afin d’identifier les aspects où nous pouvons faire la différence en poussant le collectif à adopter des politiques et des procédures plus neutres en matière de carbone», conclut-elle. «Il s’agit d’un cadre que nous devons encourager dans la philosophie politique et le débat public, car il joue un rôle vital à l’heure de motiver les gens à passer à l’action.»