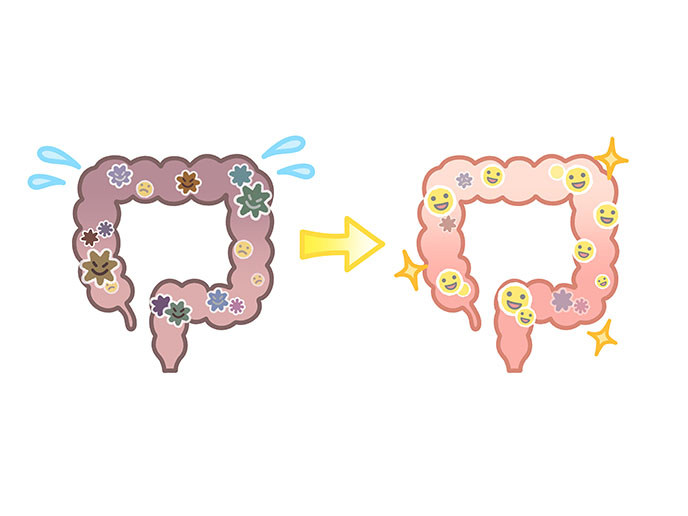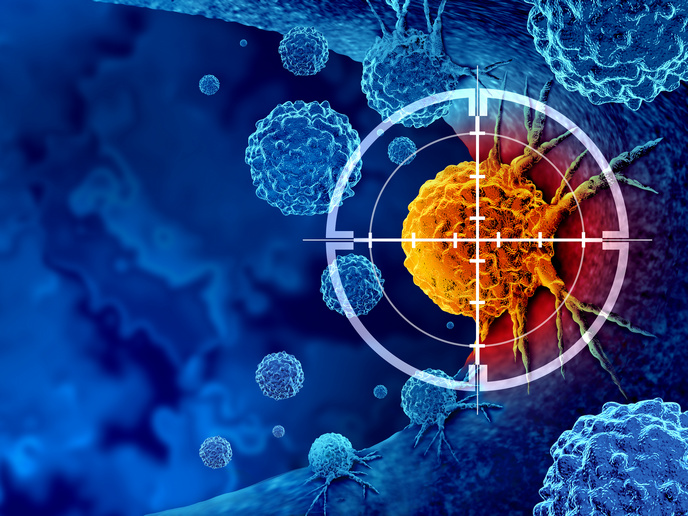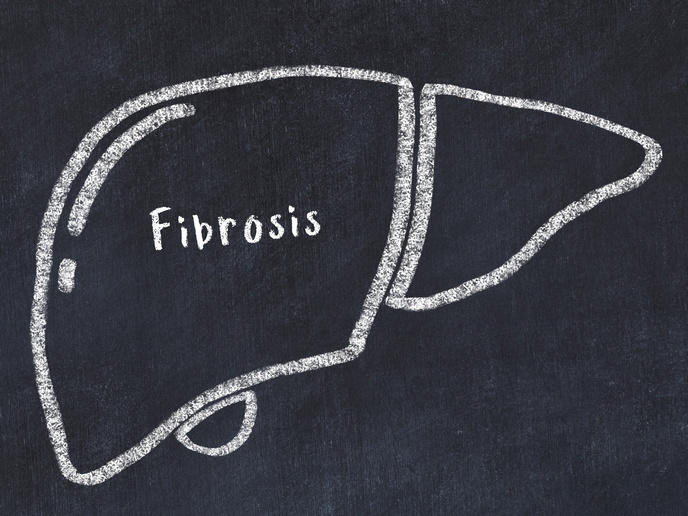Comment les bactériocines peuvent-elles influencer le microbiome intestinal?
Le microbiome intestinal humain est un espace complexe, peuplé d’un large éventail de micro-organismes, dont beaucoup ont un impact direct sur notre santé et notre bien-être général. «Ce lien évident entre le microbiome et la santé a conduit à un besoin urgent de concevoir des outils qui pourraient être utilisés pour façonner de manière prévisible le microbiote intestinal», explique Natalia Ríos Colombo, chercheuse au sein du University College Cork(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et boursière Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). L’un de ces outils est l’introduction de bactériocines, des peptides antimicrobiens produits par de nombreuses bactéries qui tuent d’autres types de bactéries. «Les bactériocines sont des modulateurs naturels du microbiome humain, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elles suscitent de plus en plus d’intérêt en tant qu’outils potentiels de modification du microbiome», explique Colin Hill(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), professeur de sécurité alimentaire microbienne à l’institut de microbiologie du University College Cork. Avec le soutien du projet BIOMA, financé par l’UE, Natalia Ríos Colombo, sous la supervision de Colin Hill, a cherché à mieux comprendre le rôle que jouent les bactériocines dans la composition et la fonctionnalité globales du microbiome intestinal.
L’impact des bactériocines
Pour commencer, Natalia Ríos Colombo a créé des souches de bactéries identiques qui produisent ou non des bactériocines, qu’elle a ensuite ajoutées à des communautés synthétiques stables. «À partir de là, nous nous sommes assis et avons attendu de voir l’impact, s’il y en avait un, et si nous pouvions le prédire», ajoute Colin Hill. Les chercheurs ont constaté que l’introduction de souches productrices de bactériocines avait effectivement un impact sur la composition globale du microbiome. Selon Natalia Ríos Colombo, l’effet le plus évident s’est produit sur les microbes sensibles à la bactériocine. Toutefois, elle a également constaté certains effets hors cible, par exemple une bactériocine nouvellement introduite peut tuer la souche bactérienne A, qui produisait déjà une bactériocine différente ciblant la souche bactérienne B. «Dans ce cas, la bactériocine introduite a entraîné une diminution attendue de la souche A, mais aussi une augmentation de la souche B qui aurait été inattendue si l’on ne connaissait pas la seconde bactériocine», remarque Natalia Ríos Colombo.
Des modèles mathématiques prédisent l’impact des bactériocines sur la composition du microbiome
Non seulement le projet a confirmé l’impact de la bactériocine sur la composition du microbiome, mais les chercheurs ont par ailleurs découvert qu’il était possible de prédire cet impact à l’aide de modèles mathématiques simples. Alors que cette modélisation mathématique ne faisait pas partie du plan initial du projet BIOMA, elle s’est avérée être l’un des principaux résultats du projet. «Natalia a demandé l’avis de mathématiciens et a introduit elle-même le modèle, ce qui nous a permis de prédire le résultat d’une expérience complexe et de le voir se dérouler dans la réalité», note Colin Hill. Cette capacité à prédire les résultats est importante étant donné que chaque fois que l’on introduit un élément dans le but de tuer une souche cible, il y a toujours des conséquences. «Avec suffisamment d’informations fondamentales, nous devrions être en mesure de prédire les effets secondaires inattendus et de prendre des mesures pour nous assurer que nous ne faisons pas plus de mal que de bien», explique Natalia Ríos Colombo.
Adapter la composition du microbiome
Si le projet BIOMA est désormais terminé, la nécessité de mieux comprendre les forces qui façonnent les microbiomes et leur fonctionnalité demeure. C’est pourquoi l’équipe de recherche étudie actuellement la possibilité de concevoir des interventions capables de manipuler volontairement les microbiomes pour en tirer des bénéfices pour la santé. «Nous avons besoin de solutions pour façonner délibérément les microbiomes, et le projet BIOMA nous a certainement fourni des outils intéressants d’y parvenir», conclut Colin Hill.