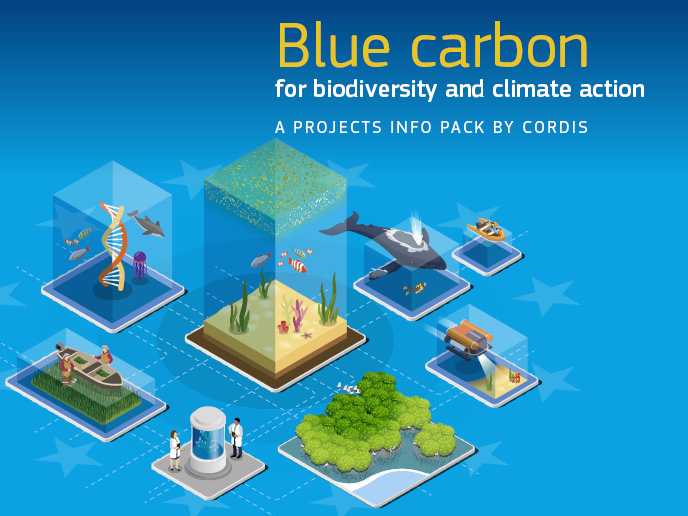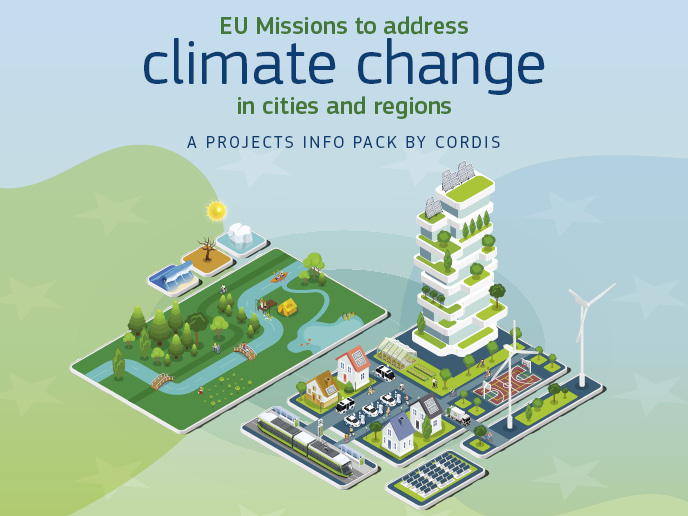Exploiter le pouvoir des connaissances indigènes
Les communautés autochtones et locales ont une connaissance approfondie de leur environnement et de sa biodiversité, et de la manière dont elles peuvent s’y intégrer de manière durable. En même temps, ces connaissances sont souvent liées à des pratiques et des normes culturelles très différentes de celles des scientifiques. Par exemple, les tabous culturels et les pratiques spirituelles de contact avec la forêt peuvent être essentiels à la durabilité locale de la conservation de la forêt, mais difficiles à relier à la compréhension moderne de la gestion des ressources naturelles. Le projet LOCAL KNOWLEDGE(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) s’est demandé comment combler cette lacune d’une manière à la fois sensible et efficace, et a développé le concept de philosophie de l’ethnobiologie. David Ludwig(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), professeur agrégé au sein du groupe Knowledge, Technology and Innovation(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (KTI) de l’université de Wageningue aux Pays-Bas, explique: «Nous considérons surtout la “philosophie” comme une pratique réflexive, qui permet de réfléchir plus attentivement à toutes les questions complexes qui émergent de la diversité des connaissances.» L’idée de l’application de la philosophie évolue. «Nous considérons également de plus en plus la philosophie comme un “médiateur” entre différentes formes de connaissances, de valeurs et de visions du monde», ajoute David Ludwig. Comme il l’explique, de nombreux scientifiques souhaitent travailler de manière plus inclusive et reconnaissent que les communautés autochtones possèdent de nombreuses connaissances pertinentes. «Mais ils ne savent pas comment aborder des connaissances qui ne correspondent pas à leurs normes disciplinaires et qui sont profondément ancrées dans les cultures locales. Ici, la philosophie peut servir de médiateur entre les différentes perspectives et contribuer à une meilleure compréhension.»
Intégrer les techniques scientifiques et les connaissances locales
Dans des domaines tels que l’agriculture, la conservation et la santé, on parle beaucoup de «l’intégration» des connaissances autochtones et académiques. Mais l’intégration est difficile et parfois impossible. Les communautés autochtones et les scientifiques utilisent des méthodes très différentes, et les connaissances qualitatives d’une communauté peuvent ne pas correspondre aux méthodes quantitatives des scientifiques. L’histoire coloniale et les différences de pouvoir peuvent rendre difficile une collaboration d’égal à égal. Les tentatives sérieuses de coproduction de connaissances doivent relever ces défis méthodologiques. David Ludwig cite l’exemple des tabous, comme l’interdiction de pêcher à certaines périodes de l’année ou de chasser dans certaines parties de la forêt. «De nombreux tabous locaux ont des justifications spirituelles et semblent difficiles à comprendre pour les scientifiques. En même temps, ils sont souvent des éléments essentiels des relations durables entre les communautés et leur environnement, qui empêchent la surchasse et l’extraction excessive des ressources», note-t-il.
Méthodologie de recherche interdisciplinaire
Pour tenter de rapprocher ces deux approches, LOCAL KNOWLEDGE a mis en place une méthodologie de recherche interdisciplinaire qui intègre l’analyse philosophique et la collaboration empirique avec trois équipes de recherche ethnobiologique au Brésil et au Mexique. Au Brésil, l’équipe(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a élaboré du matériel scolaire en collaboration avec des enseignants locaux afin de présenter les connaissances de la communauté de pêcheurs tout en les reliant aux connaissances académiques sur des questions telles que le changement climatique. «Nous avons montré que les connaissances des pêcheurs sont essentielles pour mettre en place des politiques de conservation plus efficaces qui protègent les espèces locales de poissons. Par exemple, les politiques brésiliennes actuelles interdisent la pêche pendant certains mois afin de protéger les poissons pendant la période de ponte. Mais les pêcheurs locaux nous ont dit que les lois ne correspondent pas aux mois où les poissons pondent réellement leurs œufs. L’adaptation des politiques en fonction des connaissances locales serait donc très bénéfique pour les espèces menacées», explique David Ludwig. Au Mexique, le projet a étudié les maladies végétales qui affectent les plants de café. Nombre de ces maladies sont d’origine récente et il n’existe donc pas de connaissances indigènes sur la manière de les traiter.
Répondre aux problèmes socio-environnementaux urgents
Les idées explorées par le projet sont exposées dans un livre, LINK (Transformative Transdisciplinarity), coécrit par Charbel El-Hani(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), professeur titulaire à l’Institut de biologie de l’Université fédérale de Bahia(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (site web en portugais) au Brésil. Il sera publié par Oxford University Press l’année prochaine. «En tant que philosophes, nous réfléchissons à toutes sortes de questions très pertinentes, du changement climatique à la justice sociale. Mais la manière dont notre pensée devient plus qu’un jeu intellectuel et affecte les gens n’est pas toujours claire», ajoute-t-il. «Je suis beaucoup plus heureux et confiant dans le travail que je fais aujourd’hui que je ne l’étais avant de commencer le projet Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).»