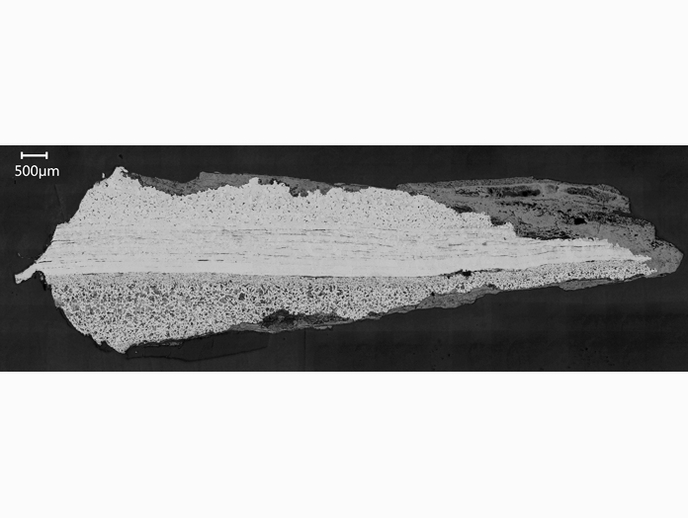Mesurer la façon dont les humains perçoivent les environnements acoustiques
L’environnement acoustique est un aspect complexe de l’expérience humaine. La pollution sonore causée par les transports, l’industrie et d’autres facteurs affecte des millions de citoyens européens, en particulier ceux qui vivent dans des zones densément peuplées. Grâce à la directive sur le bruit dans l’environnement(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), des sommes considérables sont consacrées à l’identification et à la résolution des problèmes de santé causés par le bruit excessif. Mais le niveau de bruit n’est pas le seul problème. À Londres, lors du confinement imposé en raison de la COVID-19, le volume global a considérablement diminué, mais le nombre de plaintes pour nuisances sonores a augmenté. Pour atténuer efficacement la pollution sonore, il est nécessaire de mieux comprendre comment les personnes perçoivent les sons. Le projet Sound Indices (SSID)(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE, a rassemblé plusieurs disciplines scientifiques pour mesurer l’impact des sons sur le confort humain.
Le domaine émergent des études sur le paysage sonore
Une mesure bien connue du son est le décibel(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Développé à l’origine par Bell Systems au début du XXe siècle, le décibel est un ratio destiné à mesurer la perte de signal le long des câbles téléphoniques. Aujourd’hui, les décibels sont conventionnellement utilisés pour mesurer l’intensité d’un son. Les sons supérieurs à 70 dB peuvent provoquer des lésions auditives à long terme. Bien que son histoire en tant qu’unité de mesure varie, le décibel est reconnu par l’Organisation internationale de normalisation(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (ISO) et constitue un élément important dans l’étude des paysages sonores ou des environnements acoustiques immersifs. Pour étudier les paysages sonores, il faut tenir compte de la manière dont les sons sont perçus. Les environnements acoustiques comprennent les sons environnementaux tels que le vent dans l’herbe, le chant des oiseaux et le tonnerre, ainsi que les sons produits par l’homme tels que la musique, les rires et les travaux de construction lourds. Certains sons, comme celui de l’eau qui coule doucement, sont largement perçus comme agréables. D’autres sons, comme le crissement des pneus d’une voiture, sont considérés comme désagréables quel que soit leur volume. Mesurer l’impact des paysages sonores sur les personnes est une entreprise complexe. S’appuyant sur les lignes directrices de l’ISO pour produire un cadre d’évaluation perceptuelle des paysages sonores, SSID a formé une collaboration de 24 universités dans 18 pays et en 15 langues afin de développer et de tester les indices du projet. Le coordinateur du projet, Jian Kang, de l’University College London, se projette dans l’avenir: «Les indices des paysages sonores, qui reflètent correctement les niveaux de confort humain, finiront par remplacer l’échelle des décibels, qui est couramment utilisée depuis sa création il y a un siècle.»
Normalisation des paysages sonores
La large collaboration du projet a permis d’améliorer la normalisation méthodologique afin que les résultats des paysages sonores puissent être plus facilement partagés avec les décideurs politiques et les parties prenantes. SSID a défini des descripteurs, des indicateurs et des indices du paysage sonore dans le cadre de ce processus. Les indices, qui constituent l’objet spécifique du projet, sont des échelles composites dérivées de plusieurs indicateurs qui favorisent les comparaisons entre les paysages sonores. Ces travaux alimentent directement la norme 12913 de l’Organisation internationale de normalisation(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Pour parvenir à la normalisation du paysage sonore, le projet a utilisé plusieurs outils scientifiques. Le protocole d’enquête, un questionnaire conçu pour établir une base de données sur les paysages sonores, comprend environ 5 000 réponses en plusieurs langues provenant de 54 endroits dans le monde. Outre les outils établis tels que l’échelle de Likert et les modèles de régression ordinale, le projet a également recouru à des données provenant d’évaluations physiologiques et neurologiques pour valider les indices. La réponse galvanique de la peau mesure la conductance cutanée(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et, dans les expériences de SSID, a démontré des réponses physiologiques à des stimuli sonores. Parallèlement, l’imagerie par résonance magnétique(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a servi pour étudier l’impact neurologique des paysages sonores. Les paysages sonores constituent une partie importante de l’expérience humaine et ont un impact significatif sur la santé. La conception des environnements futurs et l’amélioration des environnements existants bénéficieront de la normalisation dans ce domaine. «Les approches du paysage sonore couvrant l’acoustique, la psychologie, les mathématiques, les neurosciences, la sociologie et la linguistique contribueront à l’élaboration de solutions plus réalisables et plus rentables pour améliorer nos environnements sonores», explique Jian Kang.