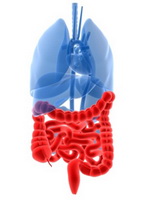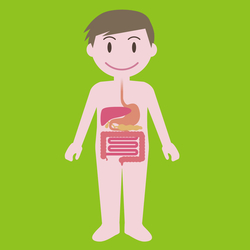Gènes et pathogènes dans les maladies inflammatoires de l'intestin
Les IBD représentent un groupe de maladies fortement influencées par l'environnement et par un terrain de susceptibilité génétique relativement complexe. Même si la microflore intestinale joue un rôle majeur dans l'étiologie de la maladie, son mécanisme d'action précis reste encore mal compris. Des travaux récents ont montré que protéases et inhibiteurs de protéases (P/PI) étaient impliqués dans l'inflammation de la muqueuse intestinale. C'est pour obtenir davantage d'informations sur le rôle mécanistique des P/PI chez l'homme que le projet Ibdase financé par l'UE a axé ses travaux sur l'analyse des associations génotype/phénotype d'une cohorte de patients en Europe souffrant de cette maladie intestinale. Le consortium a tout d'abord rassemblé et analysé toutes les études de génétique publiées sur le sujet et établi une association de tous les gènes liés à la maladie intestinale. Cette première étape a été suivie par le séquençage génétique et des études d'association génétique sur plus de 2000 patients atteints de la maladie de Crohn, 2000 patients souffrants de colites ulcéreuses et pas loin de 1800 patients en bonne santé. Les chercheurs ont analysé l'expression différentielle des gènes P/PI candidats ainsi que celle d'autres gènes liés à l'immunité sur des cas cliniques et des animaux modèles représentatifs de l'IBD. Le profil d'expression observé sur trois animaux IBD modèles montre différentes signatures génétiques pro-inflammatoires, spécifiques de chaque modèle IBD. Pourtant, deux voies moléculaires se sont révélées communes à tous les modèles, à savoir le système du complément et le système ubiquitine-protéasome. Ces voies sont également présentes au niveau des gènes P/PI et montrent la corrélation génétique la plus forte sur les cas cliniques de l'IBD. Les chercheurs du consortium ont ainsi prouvé que la microflore intestinale jouait un rôle fondamental au niveau de la régulation immunitaire, qu'elle préservait l'homéostase intestinale et qu'une carence en certains gènes induits par cette microflore pouvait conduire à l'inflammation intestinale. Ils ont montré que l'interaction entre l'un des gènes P/PI codant pour la méprine (endopeptidase-24.18) et la souche bactérienne LF82 associée à la maladie de Crohn avait un rôle pathogène pour le développement de cette maladie. Grâce à des animaux modèles déficients en certains gènes P/PI, les chercheurs ont ainsi validé le rôle de l'un des gènes P/PI les plus prometteurs et des voies moléculaires qui lui sont associées. Dans l'ensemble, le projet Ibdase a mis en évidence le rôle protecteur de la barrière muqueuse protéolytique vis-à-vis de la microflore intestinale. La modulation de l'activité P/PI représente donc une approche thérapeutique de la maladie intestinale tout aussi prometteuse que celle de la manipulation de certaines voies associées au système immunitaire. Néanmoins, la nature complexe de la maladie chez l'homme demandera à chaque fois des recherches supplémentaires pour élucider complètement les mécanismes pathogéniques de la maladie pour chaque individu.