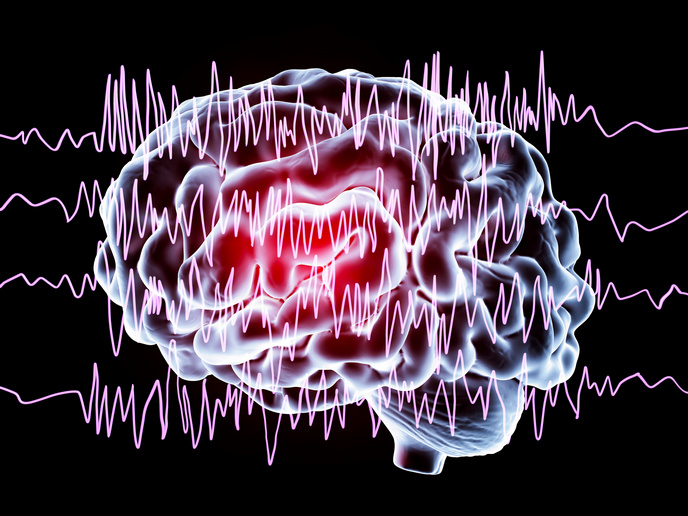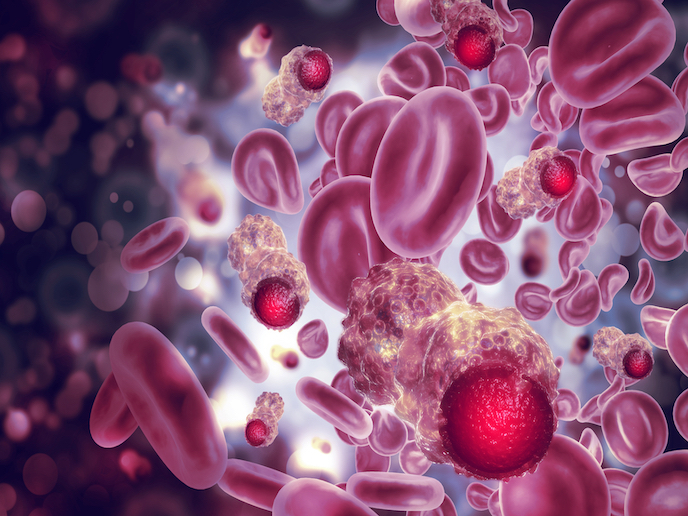Préparer les biologistes à la révolution du Big Data
Le projet DEVCOM a formé un groupe de jeunes chercheurs en biologie du développement et en biologie computationnelle. La biologie du développement étudie l'évolution d'une cellule oeuf fécondée en un organisme complet, et la différenciation en cellules spécialisées (comme les cellules de la peau ou de l’oeil par exemple). « Le volume de données collecté connaît une croissance exponentielle dans tous les secteurs scientifiques », explique le coordinateur du projet, le Dr Gert Jan Veenstra, professeur de biologie du développement moléculaire à l’Université Radboud aux Pays-Bas. « Cette masse considérable d’informations nous permet d’assurer le suivi et d’identifier des éléments impossibles à atteindre avec quelques mesures seulement. » L’ère du Big Data L’application du Big Data à la biologie du développement implique un examen plus complet du comportement cellulaire au lieu de se cantonner à chaque molécule distincte. Les innovations technologiques telles que le séquençage ont également permis une analyse du comportement cellulaire à l’échelle du génome. Toutefois, les données collectées ne peuvent pas être simplement analysées sur une feuille de calcul. Les chercheurs doivent donc maîtriser les scripts, les outils de ligne de commande et l’apprentissage machine pour analyser les données. Dès lors, les biologistes doivent disposer de connaissances computationnelles suffisantes pour exploiter pleinement ces outils. « Il existe plusieurs millions de points de données ici, et cela représente un problème pour la biologie du développement », explique le Dr Veenstra. « Les données nécessaires pour réaliser toutes les mesures sont trop volumineuses pour être exécutées sur un ordinateur portable. Il faut donc une infrastructure informatique complète et une connaissance approfondie de la biologie computationnelle. » Des compétences pour l’avenir C’est là qu’intervient le projet DEVCOM. Grâce à l’enveloppe européenne, un programme de formation pour 12 étudiants en doctorat et deux chercheurs expérimentés a été mis en place auprès de huit institutions partenaires réparties sur cinq pays. Chaque projet personnalisé comportait des réunions, des rencontres et des ateliers. Les stagiaires ont ainsi rassemblé l’expertise technique nécessaire en anatomie de l’embryon et en développement embryonnaire, en profilage génomique et en conservation des séquences ainsi qu’en spectrométrie de masse, en informatique et en modélisation computationnelle. Le programme de formation a nécessité le rapprochement de la biologie computationnelle et de la biologie du développement », explique le Dr. Veenstra. « Ces ateliers étaient interdisciplinaires et intersectoriels. Ils visaient à faire découvrir aux jeunes chercheurs l’esprit et le milieu de l’entreprise. » Outre des programmes de formation sur demande, chaque chercheur s’est vu confier un objectif spécifique en matière de recherche. « Selon nous, la formation prodiguée par ces objectifs représentait l’élément le plus important », continue le Dr Veenstra. Certaines avancées ont toutefois été possibles. Un chercheur a notamment réussi à définir un mécanisme essentiel actif lors de la différenciation des cellules et qui a laissé les scientifiques circonspects pendant plusieurs années. « Les éléments computationnels ont été essentiels dans la résolution de cette énigme », explique le Dr Veenstra. « En combinant les compétences en sciences computationnelles et en biologie, les chercheurs ont pu tirer profit des avantages des deux disciplines. Les scientifiques ont pu concevoir des expériences plus efficaces et mieux exploiter leurs analyses. Il s’agit surtout de mieux comprendre ce qui peut être réalisé. » Le Dr Veenstra est d’avis que le projet DEVCOM, qui a duré quatre ans et qui s’est achevé en août 2017, a prouvé la valeur des réseaux interdisciplinaires. Doter les biologistes des armes nécessaires pour tirer profit de la puissance du Big Data constitue un investissement important pour l’avenir. Cela contribuera à placer l’Europe à l’avant-plan dans le secteur de la recherche en génomique et amènera à de nouvelles thérapies régénératives qui pourront peut-être favoriser la création de cellules et de tissus de remplacement. « En ce qui me concerne, j’ai surtout constaté qu’il était difficile de rapprocher différents secteurs, mais le jeu en vaut la chandelle », a déclaré le Dr Veenstra. « L'on obtient bien plus que ce que l'on veut donner. »