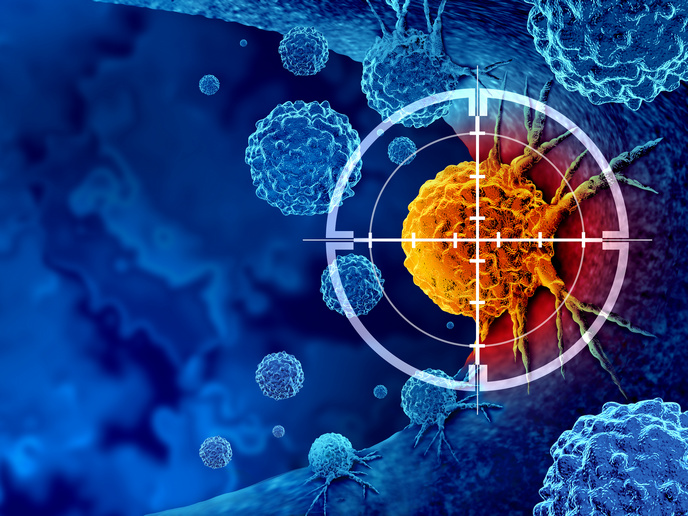Biologie des systèmes de l'évolution
La prochaine génération de biologistes devra intégrer les connaissances acquises ces dernières années en biologie développementale, bio-informatique, génomique fonctionnelle ou au niveau de la biologie de l'évolution. Cette tâche nécessite une nouvelle combinaison interdisciplinaire des formations. Le projet 'Evolution of gene regulatory networks in animal development' (EVONET) a donc mis en place un réseau de formation appliquant une approche de biologie des systèmes pour mieux comprendre l'évolution des réseaux de régulation génétique. L'un des objectifs majeurs de cette formation consistait en une intégration des différents RGG identifiés dans plusieurs systèmes animaux, représentatifs des principales lignées animales, en insistant sur le réseau de spécification du mésoderme et sur le réseau de régionalisation de la tête. Ce réseau de formation financé par l'Union européenne a pu réunir huit groupes européens don’t les chercheurs possédaient les connaissances requises pour appliquer les fondamentaux en biologie des systèmes, génomique et bio-informatique à ces nouveaux organismes modèles. Les chercheurs voulaient générer des données complètes et fiables concernant les RGG de chacun des multiples organismes modèles parmi lesquels certains vertébrés, des oursins, anémones de mer, mouches de fruits, vers polychètes, mille-pattes, tuniciers ou vers plats. Leur objectif final étant de comparer ces organismes couvrant toute la palette du règne animal afin d'identifier les nœuds génétiques conservés ou divergents et déterminer les composants de régulation développementale partagés par l'ensemble des réseaux de régulation génétique. Des analyses d'association pangénomique ont montré par exemple que le facteur de transcription Brachyury ciblait un large ensemble de gènes conservés chez l'anémone de mer et la grenouille, pourtant séparées par 600 millions d'années d'évolution. Quant à la régionalisation de la tête, les chercheurs ont analysé le profil d'expression de nouveaux gènes isolés chez le chilopode (myriapode) pendant le développement de l'animal. L'analyse comparative de leur expression a montré que ce profil était conservé entre le chilopode et la drosophile, un argument en faveur d'une origine lointaine pour le réseau de régulation génétique de la régionalisation de la tête chez les arthropodes. Les chercheurs ont identifié des centaines de gènes spécifiques potentiellement impliqués dans la capacité de régénération des cellules souches pluripotentes. Les cellules souches de planaires (vers plats non parasitaires) ont montré en particulier, une signature génétique très semblable à celle des cellules souches pluripotentes humaines, suggérant une possible utilisation de cet animal comme modèle en biologie des cellules souches à l'avenir. Ces travaux ont pour l'instant été diffusés via la publication de sept articles scientifiques. Le réseau mis en place par les partenaires du projet a également permis à de jeunes chercheurs d'acquérir les connaissances essentielles en biologie des systèmes, génomique et bio-informatique qui leur seront nécessaires pour l'étude de ces nouveaux organismes modèles.