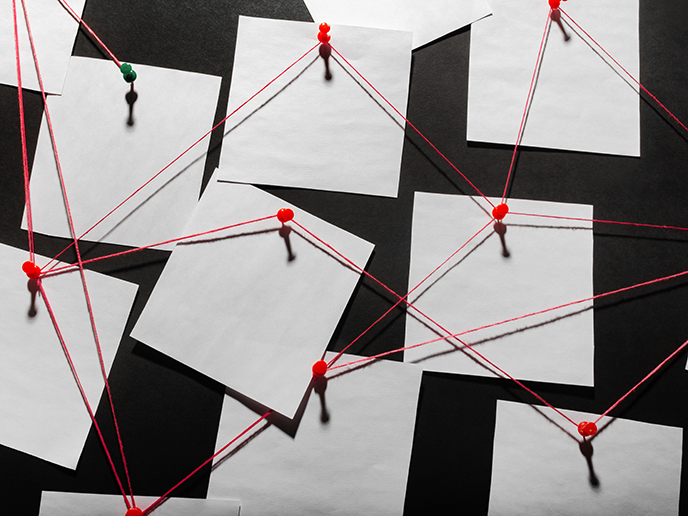Complicité et témoignages de totalitarisme dans la littérature contemporaine
Dans un contexte juridique, la complicité décrit la manière dont un crime est commis, en particulier en aidant ou en encourageant un méfait. «Dans la fiction populaire, la complicité est un objet de fascination. En même temps, il s’agit d’un défi remarquable à la maxime démocratique de la participation et au rôle de la personne en tant qu’acteur responsable dans les communautés politiques, économiques et éthiques», note Juliane Prade-Weiss, titulaire d’une bourse Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Avec le soutien du programme MSCA, le projet COMPLIT, financé par l’UE, a examiné le rôle de la langue dans des structures de complicité dans des méfaits humanitaires, politiques, écologiques, moraux et autres qui remettent en question la nature de la participation démocratique. «Ce projet interdisciplinaire met en relation de récentes recherches menées dans le domaine juridique et des sciences sociales avec des témoignages de totalitarisme dans des publications germanophones contemporaines de Herta Müller, feu Aglaja Veteranyi, et Elfriede Jelinek. L’objectif global consistait en un transfert de connaissances interdisciplinaire destiné à mieux comprendre le mécanisme de la complicité», explique Juliane Prade-Weiss.
Identifier les modes de complicité dans la violence
COMPLIT a exposé le rôle de la langue dans des structures de participation et d’implication. S’inspirant des domaines du droit et des sciences sociales, le projet a présenté la complicité comme une importante préoccupation dans des témoignages littéraires contemporains germanophones de totalitarisme qui, à ce jour, ont été essentiellement interprétés en termes de culture de la mémoire, de traumatisme, et de discours identitaires (transnationaux). «Ces textes portent tout autant sur le présent car ils évoquent des modes de participation à la violence institutionnelle qui s’inspire du patrimoine, de la culture, du genre, des caractéristiques sociales et autres. Les modes de complicité se démarquent plus clairement — et sont reconnus plus facilement — dans les dictatures du passé», souligne Juliane Prade-Weiss. Et, alors que ces modes peuvent être plus complexes dans la mondialisation actuelle, ils sont tout aussi actifs. Évoquant le principal résultat du projet, Juliane Prade-Weiss rapporte: «Nous comprenons mieux la logique de la “participation mimétique”, à savoir la participation de la critique au critiqué.» Les conclusions seront publiées en 2022 dans deux contributions aux volumes édités: «Complicities, Re-presented: Literary Portrayals in Totalitarianism and Neoliberalism’ and ‘Complicity in Commemoration: The Traumatic Enfilade in Maria Stepanova.» Le projet a également publié des premiers résultats dans un article de revue(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) évalué par des pairs: «Guilt-tripping the ‘Implicated Subject: Widening Rothberg’s Concept of Implication in Reading Müller’s The Hunger Angel».
S’appuyer sur COMPLIT
À son terme, le projet COMPLIT a été fusionné dans un projet interdisciplinaire de collaboration plus large, Discourses of Mass Violence in Comparative Perspective(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Cette fusion garantira son impact à long terme sur la recherche dans les sciences humaines et sociales, et sur le discours public, dans le débat sur la mémorisation, la politique de mémoire, et l’instrumentalisation politique des mémoires nationales. «Ce que j’ai appris sur la complicité et la participation mimétique est introduit dans ce projet, qui examine, dans une perspective comparative de longue durée, la transmission des discours qui justifient la violence de masse. La violence de masse est exercée par des groupes de personnes, et comprend des meurtres et d’autres formes de violence qui visent à exterminer de larges groupes de non combattants, comme l’expulsion, la famine imposée, le travail forcé, le viol collectif et le bombardement stratégique», souligne Juliane Prade-Weiss. Les actes de violence de masse créent des réalités socio-économiques et politiques habitées par des victimes survivantes, des coupables, des complices et leurs descendants. «Ces actes déterminent le cadre linguistique et heuristique destiné à leur évaluation juridique, morale et universitaire ultérieure, à savoir qu’ils ne sont pas à proprement parler passés mais durent, et contribuent à perpétuer les failles sociales», conclut Juliane Prade-Weiss.