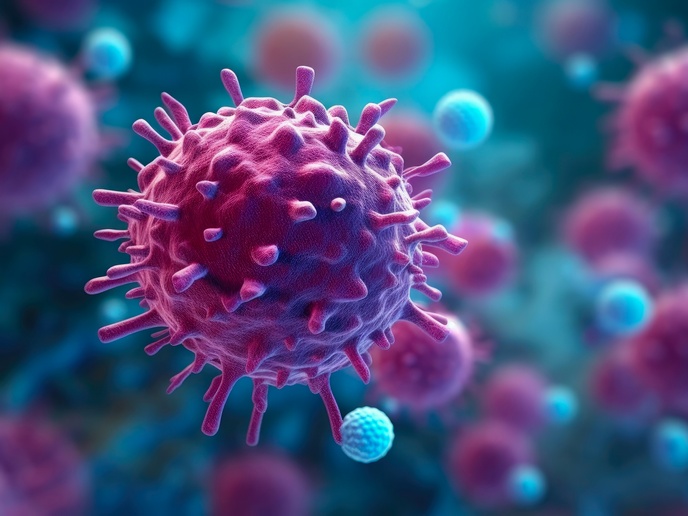Comprendre les mystérieux corps cellulaires qui aident à guérir la leucémie
Les formes aiguës de leucémie peuvent évoluer rapidement et de manière agressive. Dans ce cas, les globules blancs anormaux se multiplient rapidement, pénètrent dans la circulation sanguine et évincent les cellules sanguines saines, ce qui appelle un traitement immédiat. La bonne nouvelle, c’est que la génétique de la leucémie est plus accessibles aux scientifiques que celle des tumeurs solides. Cela a contribué au développement de nombreuses options thérapeutiques ciblées en plus de la chimiothérapie et des greffes de cellules souches. «Notre compréhension de la pathogenèse de la maladie nous a permis d’optimiser les thérapies existantes», explique Hugues de Thé, coordinateur du projet PML-THERAPY(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (Inserm) en France. «Mon groupe de recherche s’intéresse en particulier à l’identification des bases cellulaires et biologiques de la réponse de ces cancers aux traitements.»
Réponses thérapeutiques à la leucémie aiguë myéloblastique
Dans le cadre du projet PML-THERAPY, financé par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (CER), Hughes de Thé et son équipe se concentrent spécifiquement sur les réponses thérapeutiques de la leucémie aiguë myéloblastique (LAM). D’une manière générale, la LAM est une forme agressive de leucémie qui cible les cellules monocytaires ou granulocytaires. Le projet s’appuie sur les résultats de STEMAPL, un projet antérieur financé par le CER qui a permis d’identifier la base moléculaire des réponses thérapeutiques à la leucémie aiguë promyélocytaire (LAP), une forme spécifique de LAM. «Nous avons pu comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces cures, et nos résultats ont ensuite été validés auprès des patients», explique Hughes de Thé. «Les thérapies ciblées nous permettent aujourd’hui de guérir pratiquement tous les patients atteints de LAP.» L’une des principales caractéristiques des traitements validés de la LAP était leur capacité à activer les corps nucléaires de la leucémie promyélocytaire (LPM). Ces structures subnucléaires, d’un diamètre de 0,1 à 1,0 micromètre, sont présentes dans la plupart des lignées cellulaires et dans de nombreux tissus, mais de nombreux aspects de leur finalité et de leur fonction demeurent obscurs. «L’objectif principal de notre projet CER en cours est de déterminer si les corps nucléaires de la LPM jouent un rôle dans la réponse d’autres formes de leucémie à la thérapie», explique Hughes de Thé.
Des preuves de l’implication des corps nucléaires de la LPM
Pour atteindre ces objectifs, le projet combine la biochimie fondamentale, la biologie cellulaire et la thérapeutique expérimentale. Les chercheurs ont développé des modèles murins afin de comparer les réponses thérapeutiques dans des situations où les corps nucléaires de la LPM ne pouvaient plus se former. «Ces mystérieux domaines nucléaires fascinent les biologistes cellulaires depuis des années et restent un véritable défi», ajoute Hughes de Thé. L’équipe du projet a plus spécifiquement étudié les réactions thérapeutiques dans deux conditions. Il s’agit de néoplasmes myéloprolifératifs (dans lesquels la moelle osseuse produit trop de globules rouges, de globules blancs ou de plaquettes) et de LAM présentant des mutations dans le gène NPM1c. «Sans entrer dans les détails techniques, nous avons trouvé des preuves de l’implication des corps nucléaires de la LPM dans la réponse au traitement dans les deux conditions», souligne Hughes de Thé. «Forts de ces connaissances, nous avons pu élaborer, sur des modèles murins, de nouvelles approches thérapeutiques basées sur des combinaisons innovantes de médicaments.»
Nouveaux traitements et nouvelles combinaisons de médicaments
La compréhension des mécanismes moléculaires associés aux réponses thérapeutiques contribuera au développement de nouveaux traitements, notamment de nouvelles combinaisons de médicaments. Le développement de ces thérapies efficaces et non invasives apportera des avantages évidents aux patients souffrant d’un cancer et permettra aux systèmes de santé de réaliser des économies en transférant les traitements des soins de longue durée vers les traitements curatifs. «Nos études impliquent un rôle beaucoup plus large de la LPM dans la réponse au traitement que ce qui avait été initialement anticipé», fait remarquer Hughes de Thé. «Cela justifie l’importance que nous accordons à la biologie de la LPM, qui pourrait déboucher sur de nouvelles approches thérapeutiques.» Le projet PML-THERAPY se poursuit jusqu’en mars 2024, et des discussions sont actuellement en cours concernant la possibilité d’essais cliniques. «Je suis convaincu que cela se concrétisera, car le raisonnement biologique est très solide», déclare Hughes de Thé.